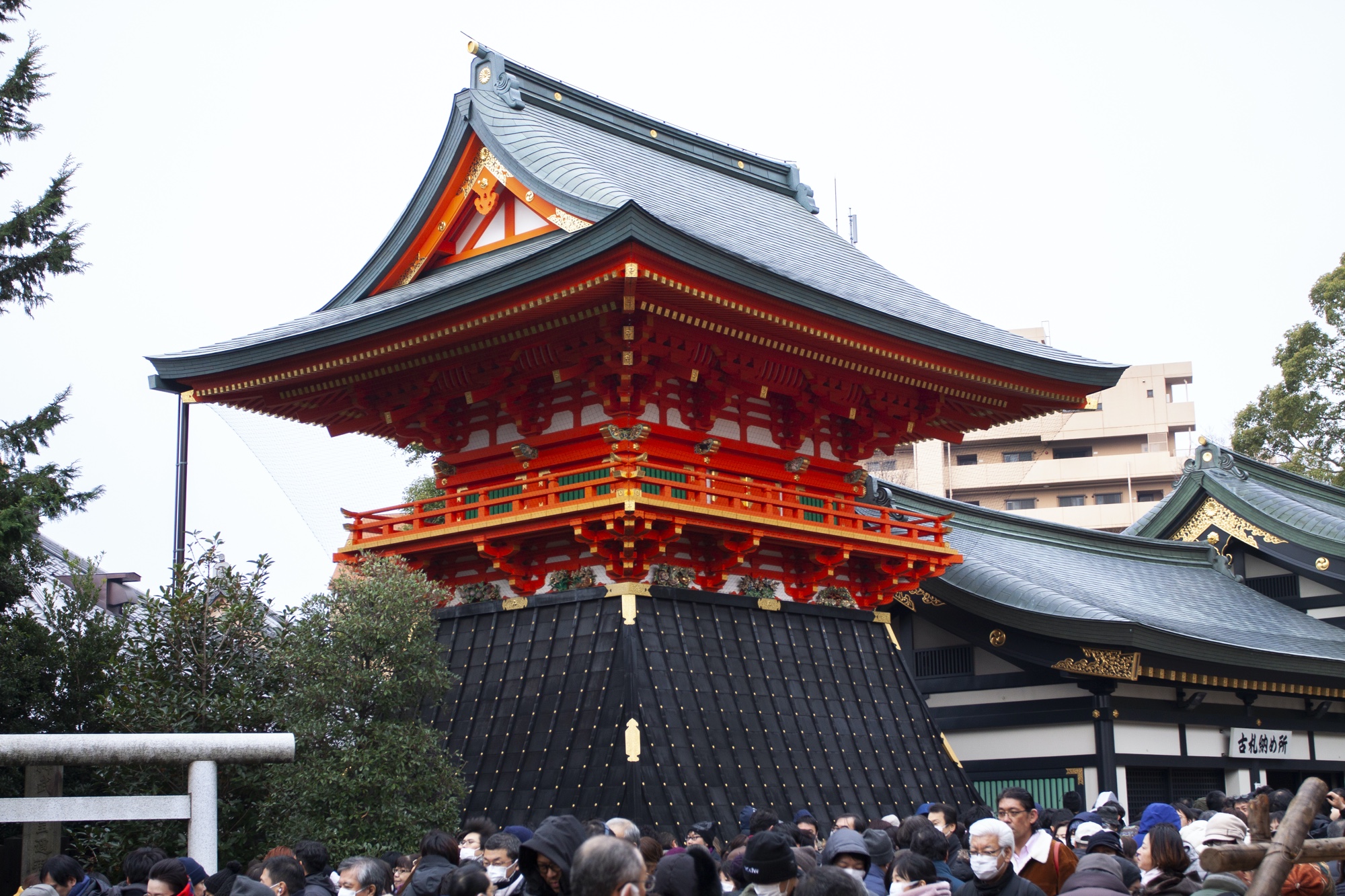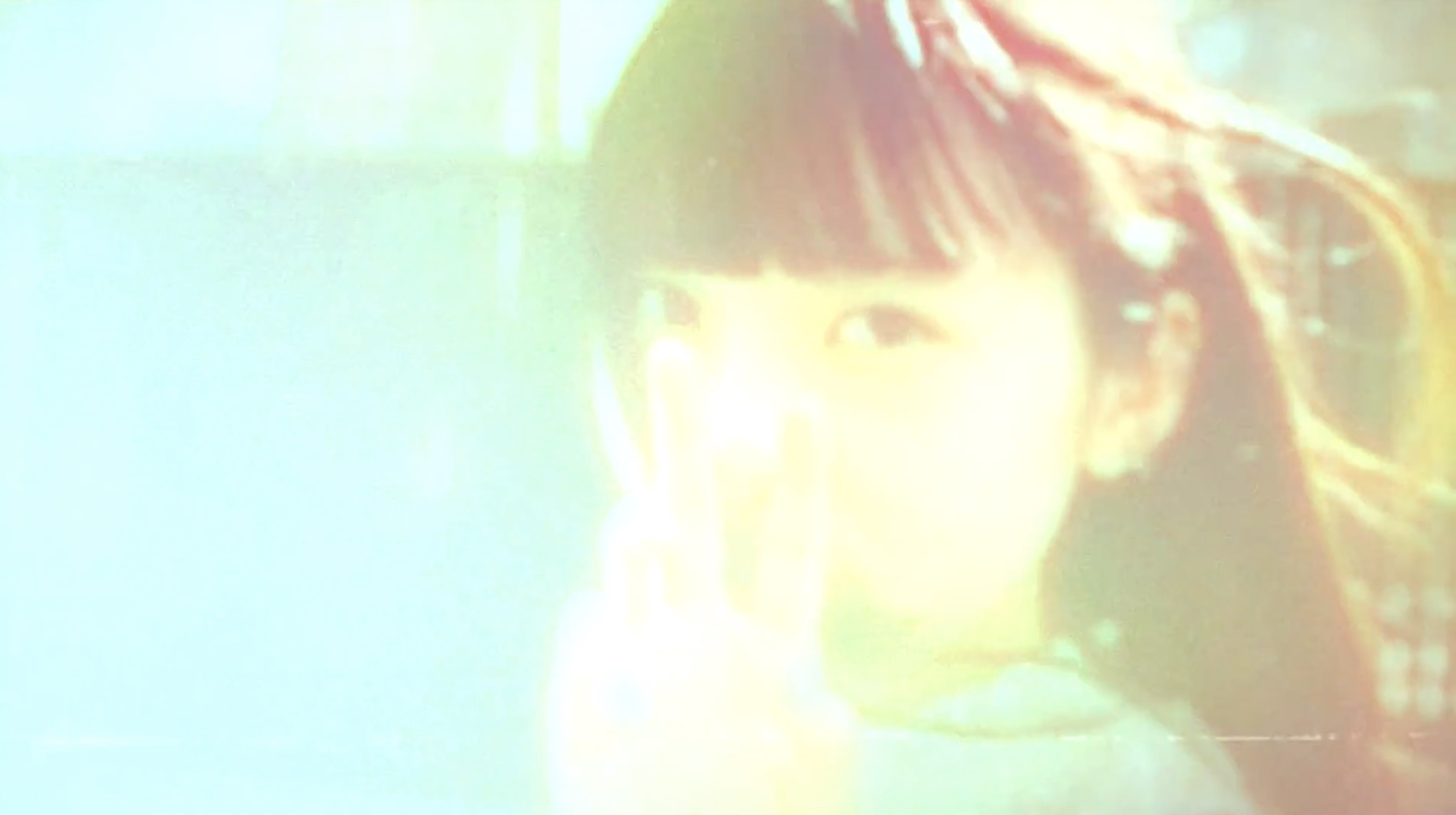Je ne vois pas beaucoup d’intérêt dans Instagram sauf quand il me fait découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles architectures intéressantes à Tokyo ou des expositions à aller explorer. Après une exposition à Hong Kong et Melbourne, l’artiste Shohei Ōtomo annonce sur Instagram une exposition soudaine au Tsutaya T-site de Daikanyama. Je me précipite donc le lendemain, un samedi matin, pour aller voir de mes propres yeux ses illustrations à l’encre, notamment Heisei Mary, dont il nous montrait dernièrement les étapes de création sur son compte Instagram. Les posters de l’oeuvre étaient malheureusement déjà en rupture de stock, mais je ne pense pas que Mari m’aurait de toute façon autorisé à l’afficher dans le salon ou au dessus de l’ordinateur. Cette figure féminine est intéressante car elle est tatouée de divers dessins représentant des images de la culture populaire japonaise et américaine. On reconnaît les personnages de Street Fighter, Dragon Ball, Death Note, Godzilla, Sailor Moon, Evangelion ou encore Kitty Chan et Pokémon du côté japonais. Du côté américain, Dark Vador se dresse à côté du Joker, de personnages de Matrix, de Harry Potter et du Pirate des Caraïbes, à côté des tours du World Trade Center en feu. Les ambiances sont mélangées car la reine des neiges côtoie la princesse Peach de l’univers Nintendo, Nausicaa de Hayao Miyazaki et les petites fleurs colorées de Takashi Murakami. Une colombe blanche, signe de paix au milieu de ces cohabitations improbables, surplombe une explosion nucléaire semblable à celle que l’on voit dans Akira de Katsuhiro Ōtomo, le père de Shohei. Il y a beaucoup de talent dans cette famille. L’exposition est malheureusement assez limitée car on ne peut y voir que quelques œuvres, notamment les figures détournées de policiers et le spectre dont je parlais déjà dans un billet précédent. J’aurais aimé en voir plus et pouvoir acheter un art book de ses œuvres, mais il n’existe pas encore. Shohei Ōtomo reste pour moi un artiste à suivre de près.


Je reprends ensuite la route dans les rues de Daikanyama en gardant un œil sur l’occupation végétale au sol et l’occupation graphique sur les murs. Cette fois-ci, deux stickers m’intriguent sur un poteau électrique, notamment un étrange casque de couleur rose inspiré de Neon Genesis Evangelion. Un lien mentionné sur le sticker pointe vers le compte Instagram d’un artiste tatoueur taïwanais appelé Che-Wei. Alors que Shohei Ōtomo dessine des tatouages de personnages du monde de l’animation sur le corps imaginaire de Heisei Mary, Che-Wei tatoue des personnages assez similaires dérivés du manga sur des personnes réelles et nous montre les résultats sur son compte Instagram. Les couleurs sont très vives et le rendu de certains tatouages est assez impressionnant. Je suis très loin d’être spécialiste ou d’avoir un quelconque intérêt pour le tatouage, mais ceux-ci m’ont l’air d’être très évolués. Après je me pose quand même toujours la question des regrets éventuels, à posteriori, d’avoir gravé un pikachu sur le bras pour toute la vie, même si celui-ci est extrêmement bien exécuté.

Je n’avais vu jusqu’à maintenant qu’un seul film de Shinya Tsukamoto, Tokyo Fist. Le film était sorti en 1995 mais je ne l’ai vu que bien après, il y a 16 ans en DVD. Ce film m’avait laissé une forte impression, mais ce n’était pour sûr pas un film facile d’approche. Je me décide maintenant à regarder un autre film de Tsukamoto, grâce aux hasards des recherches Netflix. J’étais assez surpris d’y trouver un des ses premiers films, Tetsuo: The iron man (鉄男), sorti en 1989. Tetsuo est un film à part qui ne ressemble à aucun autre, singulier et décalé. Le film en noir et blanc nous raconte l’histoire d’un salary man qui voit soudainement grandir en lui des morceaux de métal. La raison reste inexpliquée et le scénario n’est pas d’une compréhension immédiate, mais on comprend tout de même une relation psychique avec un autre homme, fétichiste du métal (si on veut bien imaginer ce que ça peut bien vouloir dire) qui le poursuit inlassablement, au fur et à mesure que le salary man développe sa transformation progressive et irrémédiable en homme-machine. Le film est conceptuel et expérimental, et n’est clairement pas adressé à un large public. L’ambiance s’apparente aux films de style cyberpunk, mais sans les effets spéciaux numériques actuels, car tous les effets spéciaux sont mis en images de manière artisanale. La manière de filmer les scènes rapides dans les rues de banlieue tokyoïte en une succession d’images coupées et séquencées, ajoutent à l’étrangeté générale de cet objet cinématographique. Le film n’est pas facile, il faut accepter une violence certaine des images, mais je suis resté scotché à l’écran pendant les 67 minutes du film. Je pense que, comme pour Tokyo Fist, Tsukamoto traite dans Tetsuo le sujet de l’aliénation humaine face à la sur-urbanisation. En pensant au titre du film, je ne peux m’empêcher de repenser au Tetsuo du manga Akira de Ōtomo sorti quelques années auparavant en 1982. De la même manière, les personnages perdent leur forme humaine et se transforment en monstre d’une manière grotesque. La différence est que le Tetsuo de Akira prenait des formes organiques tandis que le salary man du film Tetsuo voit des pièces métalliques sortir de son corps. Quoiqu’on en pense, le film ne laisse pas indifférent et je dirais même qu’il s’agit d’un chef d’oeuvre, à la fois inquiétant, effrayant et choquant, mais complètement passionnant à regarder.
Je continue avec un autre film difficile (décidément), mais dans un tout autre style que Tetsuo même s’il y a un point commun, la présence de Shinya Tsukamoto mais en tant qu’acteur. En fait, je voulais voir un film de Takashi Miike et je me suis mis à chercher ce qui était disponible sur Netflix. Je tombe sur Ichi The Killer (殺し屋1) sorti en 2001. Il s’agit d’un film de yakuza ultra-violent, et même parfois difficile à regarder mais pas de la même manière que The Forest of Love de Sion Sono, dont je parlais auparavant, car la violence ici n’est pas psychologique mais visuelle. Takashi Miike sait s’arrêter avant que la scène devienne insoutenable. Le personnage principal est un chef de gang appelé Kakihara du clan Anjo, excellemment joué par Tadanobu Asano, à la recherche de son patron qui a mystérieusement et soudainement disparu avec la caisse. On soupçonne d’abord un kidnapping par le clan rival, mais il s’avère qu’un mystérieux tueur appelé Ichi est derrière tout cela. On découvre assez vite que Ichi est un être faible psychologiquement, manipulé par un homme de l’ombre aux apparences inoffensives pour éliminer les membres des syndicats du crime en les montant les uns contre les autres. Le film s’en sort grâce à son humour pince-sans-rire, surtout celui de Kakihara, personnage sadomasochiste aux tenues exubérantes, aux cheveux teints en blond et au visage balafré. Le film ‘pince’ fort tout de même, jusqu’à la torture parfois. L’acteur fétiche de Kitano, Susumu Terajima, jouant le yakuza Suzuki doit en savoir quelque chose. Là encore, le film n’est pas pour les âmes sensibles et était même controversé à sa sortie pour ses scènes de violence souvent grotesques. Mais le scénario est habile et le jeu des acteurs très bons, dans l’excès et l’irréalisme par moment car rappelons que le film est tiré d’un manga (de Hideo Yamamoto). Je ne suis pas particulièrement amateur de films violents, mais j’aime les films de genre qui ne laissent pas indifférent. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce film montrant des yakuza avec toutes leurs attitudes excessives, ne laisse pas indifférent. En regardant le film, je me suis même dit que c’est le genre de films qui doit plaire à Quentin Tarantino. Les scènes du film se passent dans leur totalité dans le quartier chaud de Kabukichō et derrière Nishi Shinjuku, car on aperçoit souvent le bâtiment de la mairie au loin. Nishi Shinjuku me rappelle le roman déjanté de Ryu Murakami, Les Bébés de la Consigne Automatique. Takashi Miike a d’ailleurs déjà réalisé un film d’après un roman de Ryu Murakami, Audition. Je lis dans une interview de Miike sur le site consacré au cinéma japonais Midnight Eye qu’un projet pour adapter Les Bébés de la Consigne Automatique avait été lancé mais abandonné faute de financement. Peut-être que ce projet pourrait prendre un jour vie grâce à Netflix, quand on voit comment cette plateforme devient un dernier recours pour développer certains films pour lesquels les producteurs classiques restent frileux (l’excellent Irishman de Martin Scorsese par exemple). Midnight Eye est un site de référence sur le cinéma japonais mais est malheureusement devenu inactif, même si on peut toujours consulter les archives. On y trouve de nombreuses critiques de films et des interviews. Les critiques couvrent d’ailleurs beaucoup de films non conventionnels, dont ceux de Takashi Miike, mais Ichi The Killer n’y est bizarrement pas revu. Ce film me donne d’ailleurs envie de revoir les films de Hong Kong de John Woo, ceux avant sa carrière américaine comme The Killer et Hard Boiled avec son acteur fétiche Chow-Yun Fat ou encore Bullet in The Head avec Tony Leung. Et quand je pense à Tony Leung, me revient l’envie de revoir Chungking Express de Wong Kar-Wai, puis Fallen Angels du même réalisateur. Il faut que je me refasse un cycle sur le cinéma de Hong Kong des années 90.
Mais pour l’instant et pour changer de style en allégeant un peu l’ambiance, je regarde le film River’s Edge (リバーズ・エッジ) d’un réalisateur originaire de Kumamoto que je ne connaissais pas, Isao Yukisada. Le film, également disponible sur Netflix, est également basé sur un manga du même nom de Kyoko Okazaki. Je ne connaissais pas non plus les deux acteurs principaux à savoir Fumi Nikaidō jouant le rôle de Haruna Wakakusa et Ryō Yoshizawa dans le rôle de Ichiro Yamada. Ils sont tous les deux lycéens dans une banlieue quelconque près d’une rivière, dans la deuxième moitié des années 90, cette période où on n’avait pas encore de téléphone portable et de smartphone. J’ai d’ailleurs tendance à penser que les films sont plus intéressants sans smartphone, car ces objets ont souvent le pouvoir de simplifier les intrigues, en supprimant la possibilité du hasard et les situations de personnages seuls livrés à eux même. L’histoire de River’s Edge est en fait assez noire et certaines scènes sont assez crues. Les personnages sont des lycéens un peu paumés, à la recherche de repères dans leur vie. On ne peut pas dire que le film se base sur une histoire forte ou un scénario compliqué. L’interêt du film tient plus dans le jeu des acteurs et actrices, essayant de faire la part des choses entre amour et amitié. Les rapports entre les personnages sont d’ailleurs volontairement ambigus. On ressent l’amour non déclaré, qui n’est peut être qu’un très fort lien d’amitié, entre Wakakusa et Yamada, mais on apprend très vite que c’est une situation compliquée car Yamada est homosexuel et qu’il subit les harcèlements répétés et les coups d’une bande de garçons menés par le copain de Wakakusa, un grand garçon assez beau gosse aux cheveux longs appelé Kannonzaki. A ce trio, vient s’ajouter une autre lycéenne appelée Kozue Yoshizawa, modèle aux cheveux courts, poussée par ses parents dans cette voie mais qui ne croit pas en elle. Les liens qui relient Yoshizawa à Wakakusa jouent aussi beaucoup sur l’ambiguïté. Les histoires personnelles de ces lycéens et lycéennes se relient au bord de la rivière autour d’un secret macabre, mais je n’en dirais pas plus. Le film est interrompu par des interviews des personnages dans le film, comme s’il s’agissait d’interrogatoires menés par un conseiller psychologique. Ces scènes restent indépendantes du reste de l’histoire et on se demande quelle est la finalité de cet aparté. Au final, le film fonctionne grace à ses personnages et on finit par s’accrocher à cette histoire dont on ne sait pas trop où elle nous mène.